Bernard Charbonneau 1910 - 1996
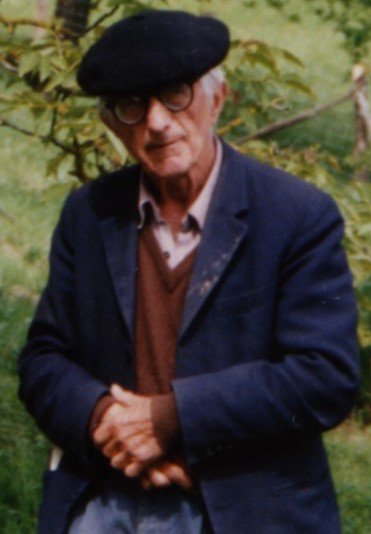
Année : 1995
Commune : Accous
Bernard
Charbonneau, l’éclaireur. 1910-1996
né à Bordeaux, décédé à Saint-Palais
voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Charbonneau
Accous-Lhers , au
berceau ou au nid de l’écologie ?
« La montagne est prête pour la venue de
l’hiver ; il ne reste plus qu’à l’attendre. Aussi loin que la vue puisse
aller s’inscrit l’irrémédiable tracé dont des générations d’hommes ont serti
leurs prés. Pas un toit de la plaine qui puisse échapper à la vue. Les vantaux
de pierre d’Esquit sont grand ouverts sur un vide … car rien n’échappe à
l’impitoyable lucidité de l’automne, surtout pas le vide. »
Cette
évocation de la limpidité de la lumière d’automne et du paysage plongeant sur
le vallon de Bedous est familière à tous
ceux qui, par une belle journée d’octobre, ont le bonheur de connaître le
plateau de Lhers. C’est avec parfois beaucoup de lyrisme et d’émotion que
Bernard Charbonneau, dans le livre « Tristes campagnes » (Denoël
1973) évoque les saisons sur le plateau de Lhers. Mais pourquoi Bernard
Charbonneau a-t-il écrit ce texte et qui est-il ?
« Bernard
Charbonneau, l’éclaireur » est le titre de l’article que lui consacre
F.Nicolino dans le Charlie Hebdo du 2 février 2022 et sous titré :
« L’ami, le frère, le complice de Jacques Ellul. »
Des convergences
d’inquiétudes…
En
1927, deux jeunes gens partagent les bancs du Lycée Montaigne à Bordeaux. De
cette rencontre naîtra une longue complicité amicale et intellectuelle,
« unis par une pensée commune ». Jacques Ellul (1912-1994),
universitaire, professeur de droit, citadin, bref maire adjoint de Bordeaux à
la Libération, homme de foi protestant, est une référence pour son analyse
critique de la société technicienne. Bernard Charbonneau (1910-1996), agrégé
d’histoire et géographie, agnostique, fait le choix de vivre en Béarn et
d’enseigner en lycée puis à l’Ecole Normale d’Instituteurs. Sa réflexion
portera surtout sur l’écologie et l’Etat.
Précurseurs
de l’écologie, par des échanges réciproques constructifs et critiques, dans des
thématiques semblables, parfois divergentes, ils seront auteurs de nombreux
ouvrages et de centaines d’articles.
Voilà
que depuis quelques années, avec la montée des inquiétudes écologique, ces deux
pensées ressurgissent à travers de nouvelles rééditions, articles et revues reconnaissant
ainsi la portée prémonitoire de leur réflexion.
Dans
le livre «Le défi de la
non-puissance » (Olivétan 2020), Frédéric Rognon rappelle « La Grande
Mue », l’actualité des thèses de J. Ellul et B. Charbonneau.
« Le sentiment de
nature »
Bernard
Charbonneau a tenu des rubriques dans l’un des premiers hebdomadaires
écologiques, entre autres « La Gueule ouverte » et « Combat
Nature ». Il a aussi développé sa pensée et sa critique philosophiques dans
le mouvement personnaliste et coopéré aux revues « Esprit » et
« Réforme ». Il y aborde tous les thèmes liés à la science, la
technique, la liberté, la justice, l’enseignement, l’argent, la culture, les
vacances, etc. Amateur de bons mots, au style parfois sarcastique et ironique,
appuyé sur des références historiques solides, il trouve souvent des formules
percutantes.
Déjà
en 1937, il publie un très long article
que certains considèrent comme le début
de l’écologie politique en France : « Le
sentiment de nature, force révolutionnaire ». C’est souvent en
montagne ou au bord de l’Océan que les deux amis organisent dès les années 30
des camps de réflexion sur les thèmes qui leur sont chers. Après la
guerre, c’est en particulier à Lhers dans la grange de Charbonneau que se déroulent
ces rencontres.
Aquarelle de B.
Charbonneau
Voici
comment il évoque ces arrivées à Lhers « Autrefois il était dur de monter
jusqu’au plateau. Pas à pas il nous fallait soulever vers le haut tout le poids
de la montagne : du matériel, des vivres ; le fardeau de notre
plaisir pesait sur nos reins ; …mais soudain nous émergions au soleil, et
le souffle de l’étendue emplissait nos poumons. Il n’y avait plus qu’à
continuer à plat parmi les prés, puis à monter jusqu’à la maison blanche posée
sur la paume du plateau. »
De
cette période il crée des formules parfois mordantes et qui souvent seront
reprises telles que par d’autres :
«Penser globalement,
agir localement.
« On ne peut
concevoir un développement infini dans un monde fini.
« Demain nous
changerons le climat.
« L’Hommauto
(titre d’un livre 1967)
« L’anarchitecture
pavillonnaire (titre de l’ouvrage paru en 1973
« La fin du paysage, avec des photos de Maurice Bardet) ;
« Le paysage est
le visage d’un pays.
« La publicité, maître à penser de nos
journées (1935).
Une réflexion
d’actualité…
Bernard
Charbonneau est aussi un homme de terrain, engagé dans des combats alliant
pensée et action. Sait-on qu’il fut cofondateur en 1964 de la SEPANSO (Société
pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-ouest),
mouvement toujours actif et nécessaire. Egalement il crée en 1973 le CDCA
(Comité de Défense de la Côte Aquitaine) qui a été et est encore un mouvement
efficace pour la préservation du littoral. En 1976, il participe à ECOROPA, un
réseau européen de réflexion écologique.
Très
tôt, Bernard Charbonneau émet des réserves sur la politique et l’écologie,
parlant de nécessaire autocritique, de « nébuleuse, …melting
pot,…secte écologiste,…intégrisme naturiste de droite,…écofascisant, ….de la
propension du mouvement écologiste à se laisser récupérer …».
On
retrouve ici le personnage méfiant vis-à-vis de l’Etat : « Dans un
monde que la technique uniformise, l’idéologie d’Etat cultive artificiellement
des oppositions qui dressent les uns contre les autres, des hommes tous
pareils, là où des différences naturelles devraient distinguer des
semblables. » (1955, article dans Réforme et repris dans « Lexique du
verbe quotidien ».)
Son
livre majeur, « l’Etat », écrit après la guerre, ne fut édité qu’en
1987 et un exemplaire sous forme de tapuscrit est resté longtemps en rayon dans
la bibliothèque de l’Ecole Normale.
Mettant
en garde contre une écologie politique totalitaire, il prône une décroissance
choisie et contrôlée et cette formule exigeante : « …et ce n’est pas
une petite affaire pour un peuple que de
diriger le dirigisme de ses dirigeants. »
« …sauver la terre et la liberté de son
locataire… »
Après
avoir longtemps habité à Laroin il se retire au bord du Gave d’Oloron à
Saint-Pé de Léren où il peut recevoir sa famille et pratiquer son goût de la
pêche. Dans un long entretien donné à France Culture peu avant son décès et
rediffusé quatre mois après sa mort, avec humour et sagesse face à sa maladie,
il se plaît à rappeler son long combat intellectuel, ses convictions, ses
engagements, son amour de la vie, du bien manger, de la montagne et de la
nature, de son métier d’enseignant, de la pêche. « Une qualité pour
moi : Jouir de la vie. »
A
plusieurs reprises il se définit comme « un emmerdeur », gênant la
pensée ronronnante.
Caricaturé par
J. Véron-Durand, élève en 1965.
Il ne faut pas oublier qu’il fut aussi un
professeur passionnant dont les cours entrecoupés de bons mots et histoires truculentes,
de réflexions sur l’actualité, ont imprégné la pédagogie des élèves –maîtres :« Ce
que nous devons à nos élèves, c’est une culture à l’humanité. »
En
1985, pour la revue Combat Nature, en une série d’articles, bilans de leurs
engagements, en parallèle aux articles de son complice Jacques Ellul, Bernard
Charbonneau conclut : « Rien n’est aussi fort, ne donne autant
de bonheur qu’une vie engagée dans une action qui ait un sens»
Jacques Ellul écrira :
« Charbonneau m’a appris à penser et il m’a appris à être un homme libre.» et Bernard Charbonneau de
compléter : «La rencontre avec Ellul m’a empêché de complètement désespérer.»
Et maintenant, avec lui,
redescendons du plateau de Lhers :
« Le père H… nous précède ; un vieil
homme qui vit seul dans la première ferme du plateau, suspendue sur un étroit
replat juste au bord de la grande descente. Il nous quitte pour s’en aller cers
sa maison ; il reste là, les cimes sur la tête et l’abîme à ses pieds, au
terme de sa route. C’est la dernière maison de Lhers, au départ du raccourci
qui plonge vers la vallée : un monde finit et un autre commence avec la
croix qui le signale.»
Francis
Castéra